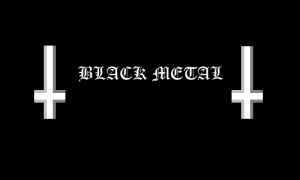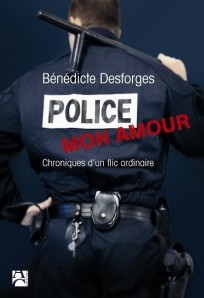#13 L., chauffeur d’Orlybus
Le chauffeur au bout des bras a le regard qui va dans le mur, quelqu’un pour prendre le relais? Ecrasée contre sa cabine, je suis la mieux placée: « Combien d’allers-retours par jour ? » A côté, une quinqua coincée entre deux valises et la barre d’appui saisit la perche: « Et c’est toujours comme ça? ». Le regard de L. soupire, ses soupirs sont plus monocordes que la moyenne parisienne. « Là, encore, ça va, des fois, j’en laisse 200 sur le trottoir ».
Parce que ça fait 8 mois. L’alliance infernale entre une augmentation de capacité de 4% de voyageurs à Orly et le dézonage du passe Navigo. Le Stif, censé coordonner le trafic, coordonne surtout l’immobilisme. « Derrière les discours policés, y’a que les économies qui comptent », lâche L.
La première impression des touristes en arrivant à Paris ? « Là haut, ils s’en foutent royal ». L. enfile sans crier gare la panoplie du syndicaliste, mais quelque chose dans le masque ne lui va pas au teint. Il a beau fulminer, le volcan reste éteint.
En première ligne, L. aussi s’en fout royal. Une mer d’huile. Il n’attaque pas. Il ne se défend plus. Entre baïonnette et bouclier, il a refusé de trancher et se fout en boule pour laisser couler. Il laisse passer les insultes quotidiennes des passagers frustrés, les injonctions paradoxales de ses chefs, qui lui demandent de vérifier les validations de tickets quand même l’air se fraie difficilement un passage entre les gens. Quand les fraudeurs refusent de coopérer et que le temps passé à négocier grignote encore un peu plus l’air entre les gens…
L. n’a plus beaucoup de rêves. Il n’attend qu’une dépression salvatrice. Elle est son seul projet, la seule idée qui l’anime. Positionné en haut de la pente, il attend la descente, l’échafaud serein.
En attendant, insultez-le, « plus y’en aura, plus vite je pourrai me faire arrêter », lâche-t-il sans un coin de sourire. Il n’a même pas baissé les bras, il fait juste le dos rond. Il cultive sa léthargie en attendant que ses symptômes soient assez mûrs pour la cueillette.
La résignation calme, la désertion tranquille, il se dit juste « lessivé ». Là, derrière son hublot, il attend gentiment que s’arrête la machine à laver.
L. planifie son désespoir comme un autre ses RTT. On n’entre pas n’importe quand en désespoir. L. attend d’avoir achevé sa semaine de formation « qui ne va servir à rien » et d’avoir effectué encore quelques dizaines d’allers-retours entre Paris et Orly.
Il ira voir le médecin juste avant de craquer complètement, parce que « quand on commence à fermer les yeux sur la route, c’est pas terrible », dit-il en jetant un cil sur sa fournée d’humains. Il tient un discours de fin de parcours, de néon clignotant.
« Et ça vous arrive souvent, de fermer les yeux sur la route ? »
…